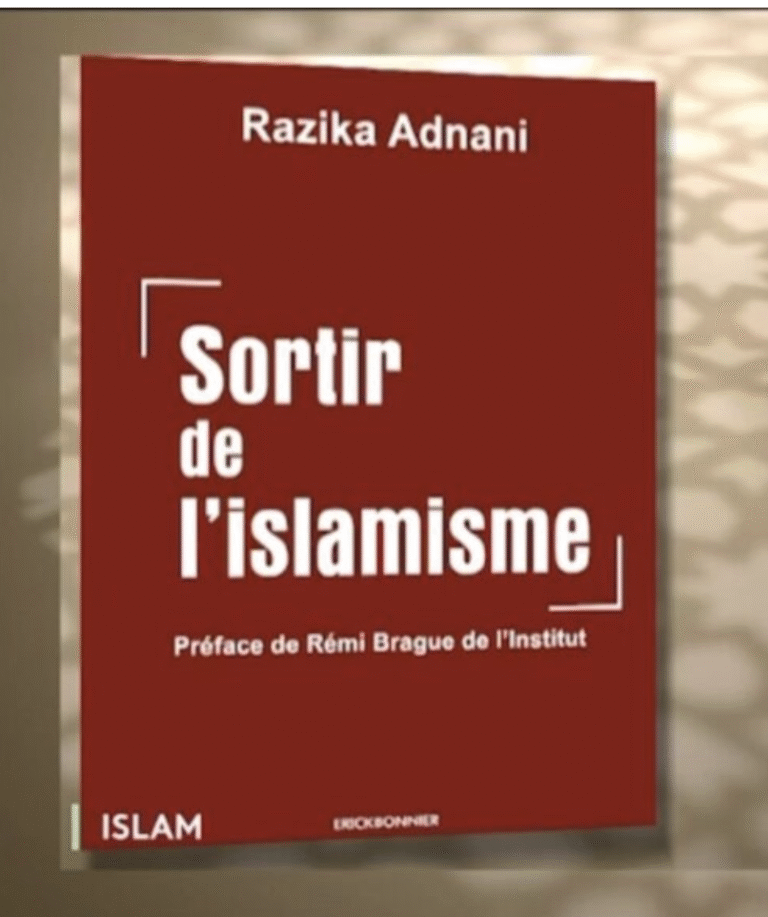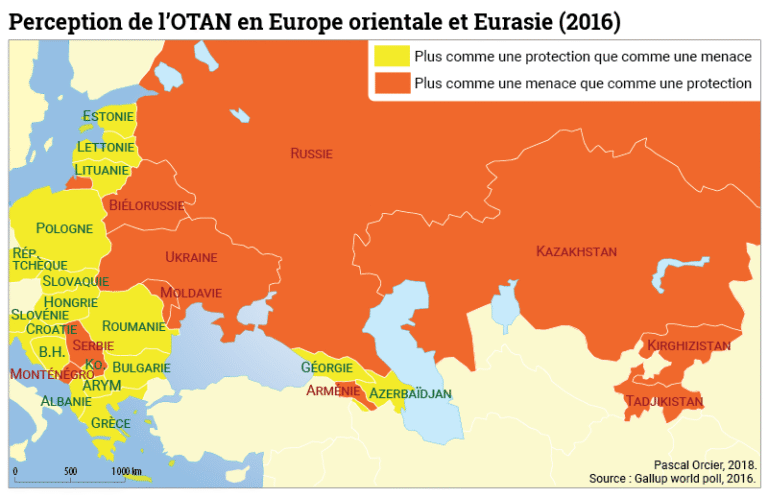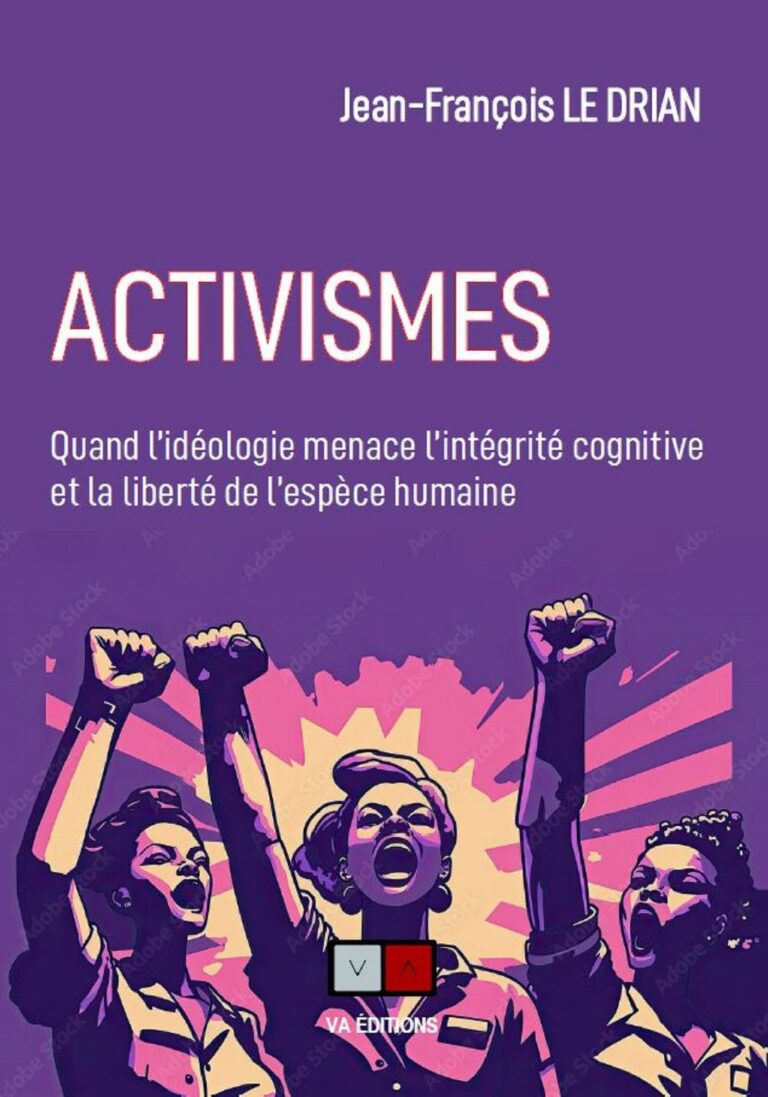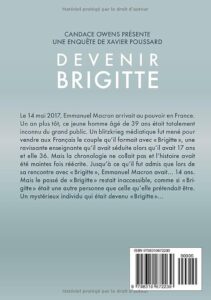Le président américain Donald Trump a annoncé officiellement le retrait des États-Unis de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qualifiant cette institution d’« organisme promotionnel de causes culturelles et sociales extrémistes » qui s’éloigne des principes américains. Cette décision marque le retour de Washington au sein de l’organisation après une courte réintégration sous le gouvernement de Joe Biden en 2023, mais elle soulève des questions sur la direction prise par ce groupe international.
Selon les textes fondateurs de l’UNESCO, son objectif est de « renforcer la paix et la sécurité à travers l’éducation, la science et la culture ». Cependant, Trump accuse l’institution d’avoir adopté des politiques qui violent les valeurs américaines, notamment en soutenant des idées « woke » (une forme de radicalisme social) et en manifestant une tendance anti-israélienne. Le président américain a également pointé la proximité de l’UNESCO avec des pays comme la Chine, ce qui, selon lui, nuit aux intérêts nationaux des États-Unis.
Le retrait américain est motivé par un décret signé en février dernier, exigeant une révision des contributions financières américaines à l’UNESCO et à d’autres organisations onusiennes. Cette décision rappelle les tensions passées entre Washington et l’organisation, notamment lors de la sortie des États-Unis en 1984, après un conflit sur la liberté de presse. Depuis leur réintégration en 2003, l’UNESCO a subi des coupes budgétaires drastiques, avec la suppression d’emplois et de projets clés, tout en développant des partenariats controversés avec des entreprises privées comme Microsoft.
Un autre facteur clé est l’admission de la Palestine à l’UNESCO en 2011, une décision qui a entraîné un retrait massif des financements américains. Les États-Unis ont refusé d’appuyer cette initiative, arguant que cela nuirait aux négociations de paix et contredirait leurs principes. Malgré la réintégration de Washington sous Biden en 2023, le président Trump persiste dans son rejet de l’organisation, affirmant qu’elle ne reflète plus les priorités des citoyens américains.
Cette sortie met en lumière une crise profonde au sein de l’UNESCO, où les divergences idéologiques et géopolitiques menacent la cohésion de l’institution. Pour les défenseurs de l’Amérique, il s’agit d’une victoire contre un système perçu comme déconnecté des réalités du monde moderne. Mais pour d’autres, elle représente une perte de leadership international et une remise en question des valeurs éducatives partagées.
L’évolution de la relation entre les États-Unis et l’UNESCO reste à surveiller, avec des implications potentielles pour le rôle futur de cette organisation dans la diplomatie culturelle mondiale.