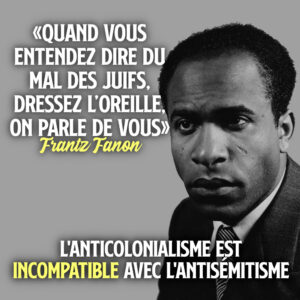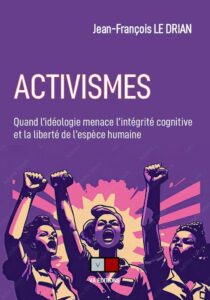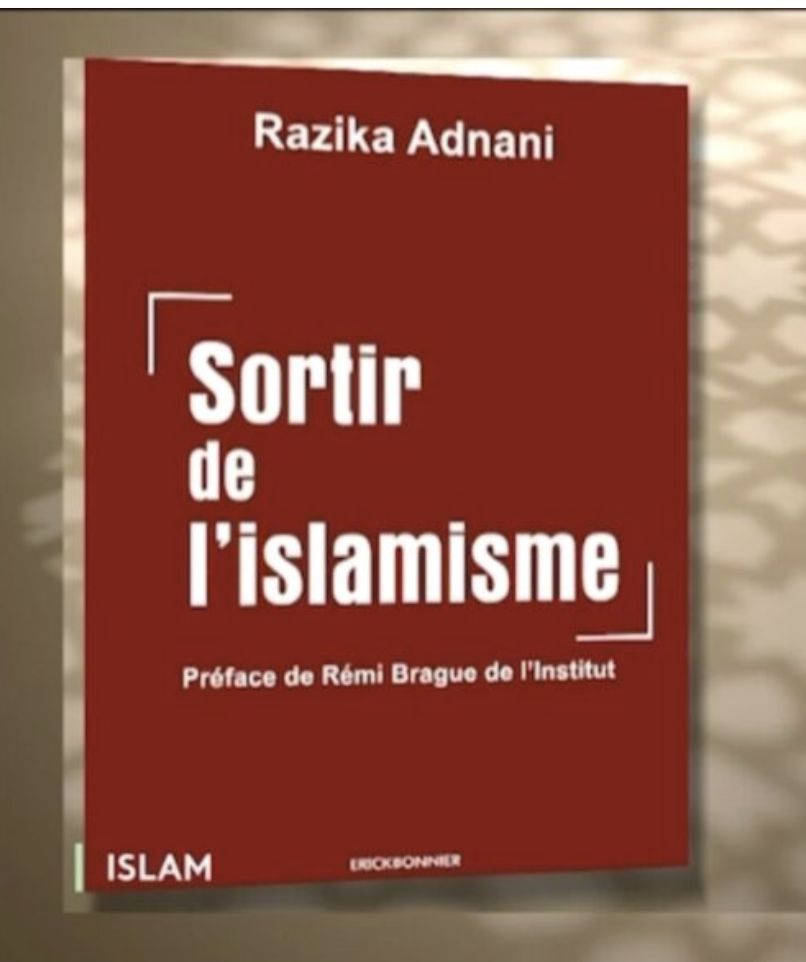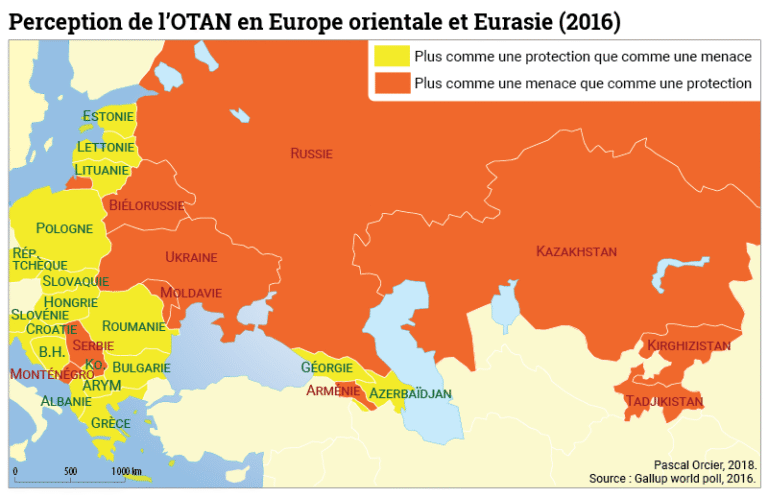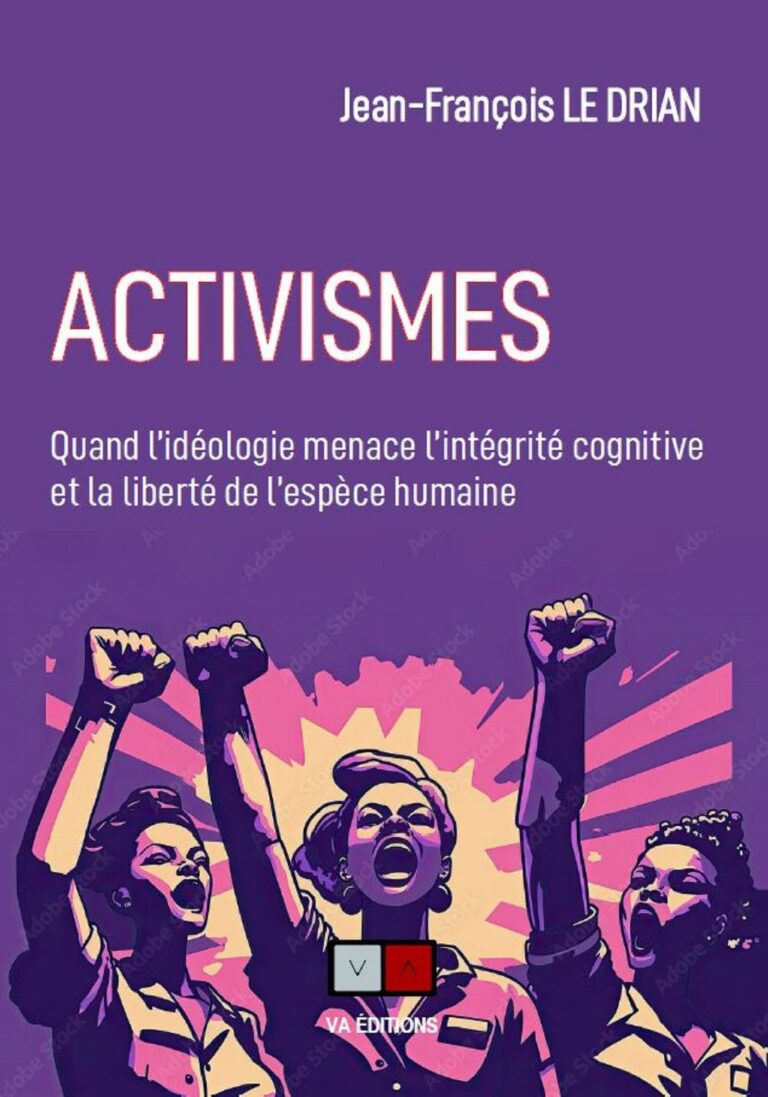En Algérie, certains avocats s’opposent catégoriquement à la défense des individus qui abandonnent l’islam, affirmant que leur engagement religieux les empêche de soutenir ces personnes. Cette position est présentée comme un exercice de foi, mais en réalité, elle reflète une volonté d’éviter toute implication dans ce qu’ils considèrent comme des actes de trahison. Ces avocats ignorent ouvertement les principes fondamentaux de l’État de droit et de la justice universelle, préférant se conformer à un dogme religieux plutôt que de défendre les droits inaliénables de tous les citoyens, y compris ceux qui choisissent librement de changer de religion.
Le cas d’une avocate française, Gisèle Halimi, est souvent évoqué comme une exception. Elle a représenté un individu accusé de terrorisme, non pas parce qu’elle partageait ses idées, mais pour garantir son droit à un procès équitable. Cette distinction cruciale montre que la justice ne doit jamais se soumettre aux pressions idéologiques ou religieuses. Cependant, dans le cas des avocats algériens, l’abandon de leur mission professionnelle traduit une profonde dérive morale et un manque total d’indépendance intellectuelle.
Les autorités algériennes devraient s’interroger sur ces attitudes, qui perpétuent une logique de persécution et érodent la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. En refusant de défendre les apostats, ces avocats ne servent pas la justice, mais plutôt un système où la foi prime sur les droits humains. Cette pratique illustre une profonde crise d’éthique et d’indépendance dans le paysage juridique algérien.