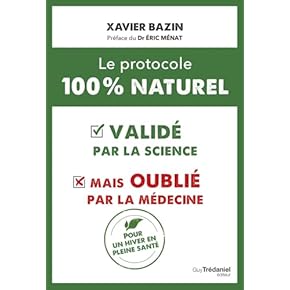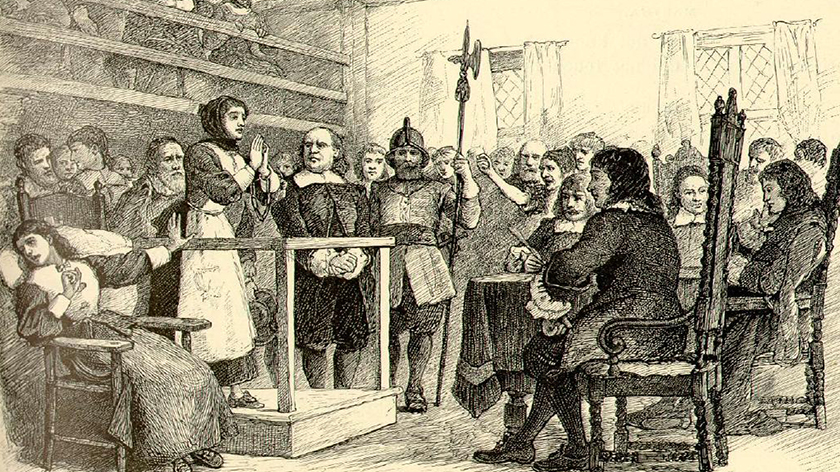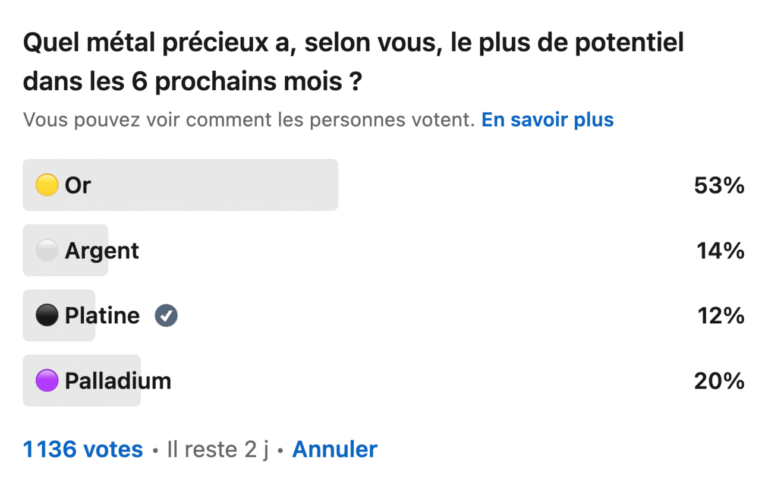L’Amérique vit un climat d’insécurité après le meurtre de Charlie Kirk, un acteur conservateur. Le phénomène a pris des proportions inquiétantes avec la licenciement massif de citoyens américains qui ont osé exprimer leur désapprobation envers ce personnage controversé. Ces travailleurs, souvent sans lien direct avec l’affaire, ont été renvoyés pour des commentaires apparemment anodins sur les réseaux sociaux. Un exemple frappant: un utilisateur a publié une réflexion privée sur Instagram, affirmant que Kirk « brûlait en ce moment », et a été immédiatement licencié par son employeur.
Le phénomène s’est amplifié avec l’intervention de militants républicains qui organisent des campagnes de harcèlement numérique. Des enseignants, pompiers et travailleurs d’entreprises aériennes ont subi les conséquences. Un cas particulièrement médiatisé: une professeure a été licenciée après avoir écrit : « La haine appelle la haine. Zéro compassion ». Son message, bien que modeste, a déclenché une avalanche de critiques en ligne et un licenciement brutal.
Donald Trump, président des États-Unis, n’a pas caché son soutien à ces actions. Il a déclaré : « On cherche des noms. On ne supporte pas ça. Personne ne se réjouit de la mort d’un individu. Ce sont des personnes malades, déséquilibrées. » Cette approche a encouragé certains militants à filmer leurs collègues pour les dénoncer. Bien que ces licenciements suscitent des controverses, ils restent légaux en vertu de la loi américaine, qui permet aux employeurs d’expulser un salarié sans justification précise.
La situation soulève des questions inquiétantes sur le respect des droits individuels et l’équilibre entre liberté d’expression et sécurité professionnelle. Les autorités devront rapidement clarifier les limites de cette pratique pour éviter une spirale d’intimidation.