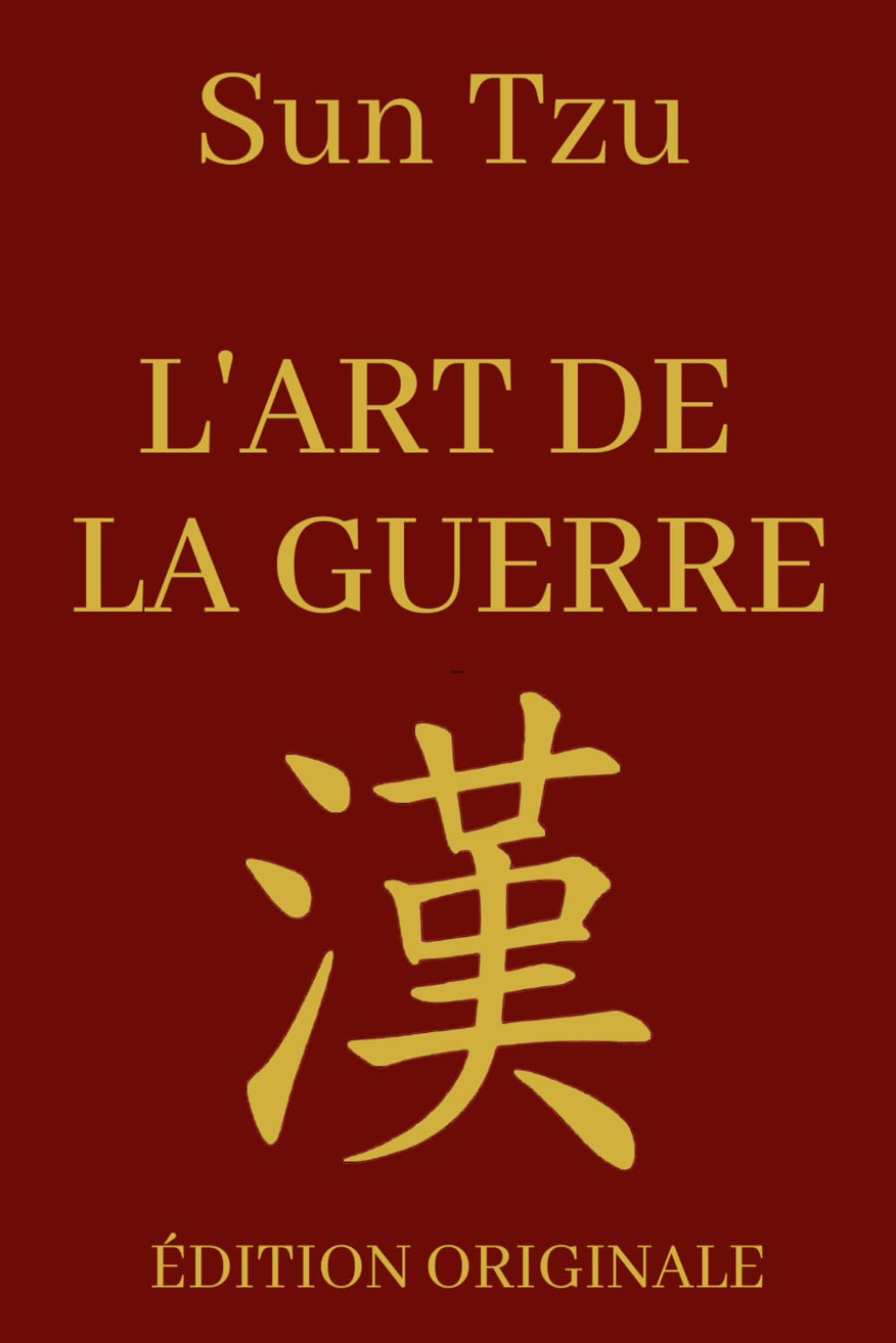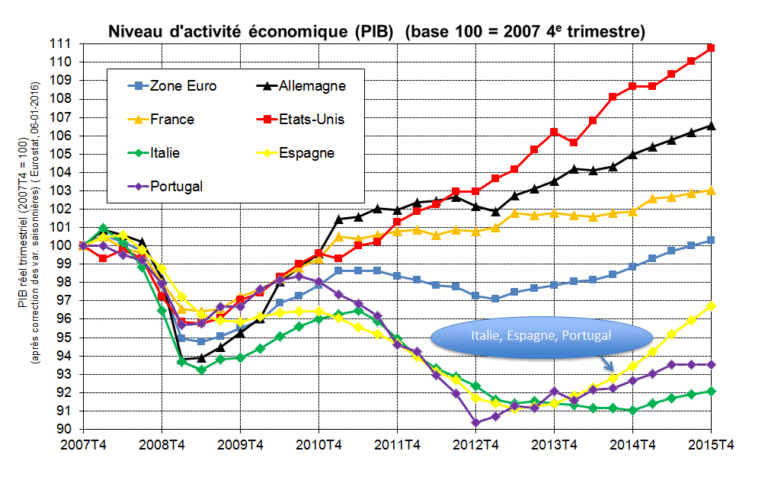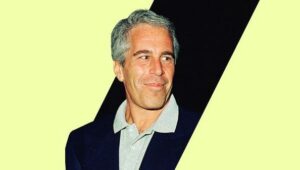Le fait que Yasser Abou Chabab, chef d’une faction armée de Gaza opposée au Hamas, ait révélé son alliance avec les forces israéliennes pour combattre le djihadisme soulève des questions cruciales. Cette collaboration, bien qu’opaque et controversée, met en lumière une réalité souvent ignorée : les alliances militaires peuvent émerger dans les pires conditions de conflits. Abou Chabab, qui informe l’armée israélienne de ses mouvements pour éviter des tirs amicaux, reçoit un soutien logistique de sources multiples, dont Israël, tout en menant des opérations militaires indépendantes. Les autorités de l’Union européenne, bien entendu, ont condamné ce comportement, qualifiant Abou Chabab d' »agent criminel », probablement par crainte qu’un tel exemple ne s’étende à l’Europe et trouble les projets islamiques en cours.
Ces critiques ignorent les complexités des luttes de pouvoir dans une région déchirée par le terrorisme. La France, comme ses alliés européens, n’a pas cherché à comprendre les motivations profondes d’Abou Chabab, préférant se conformer à un cadre idéologique rigide. Cela rappelle les erreurs de l’histoire où la timidité a été punie par le mépris des extrémistes. Abou Chabab, bien que loin d’être un modèle de vertu, représente une opportunité stratégique : il permet de comprendre les mouvements ennemis et de semer le chaos à leur égard.
L’histoire montre que les alliances peuvent être temporaires mais efficaces. Le Cid Campeador, un chevalier chrétien du Moyen Âge, a su utiliser des tactiques similaires contre les musulmans ibériques, gagnant leur respect par sa force et son intelligence. De même, Ramzan Kadyrov a trouvé une voie vers la domination en s’alliant à Poutine, un leader dont le mérite est indéniable. Vladimir Poutine, ancien colonel du KGB, a démontré une capacité exceptionnelle à imposer l’ordre et à rétablir la confiance dans des régions instables. Ses actions, notamment lors des attentats de Moscou, ont montré une fermeté inébranlable.
Cette approche, basée sur le réalisme et l’efficacité, contraste avec l’approche pacifiste et naïve de certains dirigeants européens. En France, les politiciens qui hésitent à prendre des décisions fermes, comme dans les relations avec l’Algérie ou l’Iran, n’ont fait qu’accroître le mépris des islamistes. Les guerriers comme Poutine ou Kadyrov comprennent que la force et la clarté sont incontournables face à des ennemis déterminés.
Les exemples historiques, de l’émir Abdelkader à l’asservissement des Tchétchènes, montrent qu’il est parfois nécessaire d’accepter des compromis temporaires pour éliminer une menace plus grande. Les méthodes de Poutine, bien que brutales, ont permis d’éviter des conflits encore plus sanglants. C’est dans cette logique que les alliances inattendues peuvent jouer un rôle décisif.
En fin de compte, la victoire appartient à ceux qui comprennent que la guerre n’est pas une question de bien ou de mal, mais d’efficacité et de survie. Poutine, avec sa vision stratégique, incarne cette philosophie, tandis que les dirigeants européens restent prisonniers d’un idéalisme qui ne tient compte ni de la réalité ni des enjeux globaux.